|
EN BREF
|
Le Label Bas-Carbone (LBC), établi en 2018 par le Ministère de la Transition Écologique, vise à financer des projets bénéfiques pour le climat dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Après six années de mise en œuvre, le LBC a validé 1 685 projets représentant un impact potentiel de 6,41 MtCO2eq, axés principalement sur les secteurs agricole et forestier. Cette étude évalue les pratiques sur le terrain, leur impact climatique et leur robustesse, tout en anticipant une révision des textes de référence prévue entre 2024 et 2025. Les résultats montrent une forte dynamique, notamment avec une majoration de l’offre en projets, et soulignent la nécessité de poursuivre des efforts en matière d’évaluation et d’amélioration continue des méthodes de quantification et de gouvernance. Les enjeux de transparence et de financement demeurent cruciaux, en particulier pour renforcer la demande des projets, notamment dans le secteur agricole.
Mis en place en 2018 et soutenu par le Ministère de la Transition Écologique, le Label Bas-Carbone (LBC) a pour objectif de financer des projets jugés « positifs pour le climat ». Au cours de ces six dernières années, le LBC a démontré sa capacité à certifier l’impact climatique d’activités françaises, notamment dans les secteurs agricole et forestier. Cet article présente une analyse des avancées, des projets réalisés, des défis rencontrés et des perspectives d’avenir pour cet instrument de financement environnemental, en mettant en lumière les facteurs qui ont façonné son évolution et son efficacité.
Origine et objectifs du Label Bas-Carbone
Le Label Bas-Carbone a été conçu dans le contexte de la Stratégie Nationale Bas Carbone, une politique française visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Son but principal est de faciliter le financement de projets qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, tout en s’assurant que ces projets aient un impact réel et mesurable sur l’environnement.
Il repose sur des critères rigoureux tels que l’additionnalité et les impacts environnementaux, afin d’évaluer la validité de chaque projet. Les financements proviennent principalement du secteur privé, avec un modèle qui incite les entreprises à compenser ou contribuer à la réduction des émissions de carbone.
Les chiffres marquants des six dernières années
À la date du 31 mars 2025, le LBC a validé un total de 1 685 projets, représentant un impact potentiel de 6,41 MtCO2eq. Ce chiffre montre une dynamique significative, notamment avec un doublement des projets validés en 2024 par rapport à 2023.
Les pratiques de boisement et de reconstitution de forêts dégradées occupent une place centrale dans ces projets, représentant des opportunités notables pour capturer le carbone et améliorer la biodiversité des territoires français. De plus, le développement de projets en agriculture est également à signaler, où des méthodes collectives sont mises en place pour maximiser l’impact.
Les projets forestiers : focus sur le reboisement
Les projets forêt représentent une part significative de l’impact potentiel quantifié par le LBC. Sur les 1200 projets forestiers, plus de 12 000 ha ont été soumis à reboisement, générant environ 3,3 MtCO2 potentiels. Ce chiffre comprend :
- Boisements (3 800 ha) ayant pour origine d’anciennes terres agricoles, contribuant à 1,26 MtCO2.
- Reconstitution de forêts post-incendie (5 000 ha) principalement en Nouvelle-Aquitaine, suite aux incendies de 2022, représentant 1,02 MtCO2.
- Dépérissements forestiers (3 300 ha), touchés dans le Nort-Est de la France, qui supplémentaires 0,71 MtCO2.
L’engagement croissant des secteurs agricole et forestier
Les retours d’expérience montrent que les secteurs agricole et forestier ont considérablement investi dans le développement de projets sous le LBC. Ce soutien va au-delà des simples aport financiers ; il se manifeste par une volonté d’engagement sur les enjeux climatiques et leur impact sur les pratiques agricoles.
Ces projets sont portés par une dynamique d’apprentissage entre agriculteurs, favorisant la montée en compétence sur la gestion des ressources et la construction de modèles économiques durables. Ce mouvement a également engendré l’émergence de nouvelles entreprises qui se développent autour de solutions innovantes et durables.
Les limitations et défis rencontrés
Alors que le LBC a connu des succès notables, il ne vient pas sans défis. Certaines limites en termes d’intégrité environnementale et d’évaluation des projets ont été identifiées. Entre les effets d’aubaine potentiels et la difficulté de quantification des résultats, la perception globale du label mérite une évaluation critique.
De plus, malgré le nombre croissant de projets, la demande volontaire demeure fragile, en particulier pour les projets agricoles, qui ont plus de mal à mobiliser les financements nécessaires. Les agriculteurs éprouvent des difficultés à communiquer sur leurs projets, souvent jugés moins attrayants par rapport aux projets forestiers en raison de leur narrative moins séduisante.
Mesurer l’impact : méthodes et processus d’amélioration continue
Les méthodes de quantification des impacts carbone sous le LBC évoluent également. La mise en place progressive de normes et d’exigences a renforcé la rigueur des calculs. Le processus d’amélioration continue est central pour le LBC, permettant de rectifier les faiblesses identifiées et d’adapter les méthodes aux avancées scientifiques.
Avec l’imposition de seuils minimums de mélange pour diversifier les essences plantées, une meilleure quantification des gains carbone se profile à l’horizon. Les résultats des quantifications sont cruciaux pour s’assurer de la robustesse et de la crédibilité du label.
Les financements et la dynamique du marché
Historiquement, le financement des projets bas-carbone a été assuré par des entreprises françaises qui ont souscrit aux contributions volontaires, payant ainsi un prix moyen de 35 €/tCO2, soit bien au-dessus des standards internationaux. Cependant, la récente dynamique réglementaire, accentuée par la loi Climat et Résilience, a également vu émerger une demande réglementaire qui est désormais dominante.
Cette nouvelle demande a été particulièrement forte chez les secteurs obligés, tels que certaines compagnies aériennes, qui ont cherché à compenser leur impact. L’attrait du LBC réside dans sa crédibilité mais également dans sa capacité à mobiliser un éventail varié d’acteurs autour des enjeux climatiques dans un cadre structurant.
Perspectives d’avenir et nouveaux défis
En regardant vers l’avenir, le LBC doit affrontés plusieurs défis cruciaux. Tout d’abord, l’introduction d’audits indépendants et obligatoires des projets cinq ans après leur validation vise à garantir la véracité des impacts déclarés.
En parallèle, le cadre européen de certification carbone présenté par le CRCF constitue à la fois une opportunité d’amélioration et un risque potentiel. Une intégration du LBC à ce cadre pourrait imposer des changements profonds, tandis que rester indépendant pourrait amener à une baisse d’attractivité pour les grands groupes.
Conclusion : une gouvernance à renforcer pour plus de transparence
La gouvernance autour du LBC doit continuer d’évoluer pour assurer une transparence accrue dans le processus d’évaluation et d’instruction des projets. Si des étapes ont été franchies, une approche plus collaborative et interactive avec les parties prenantes serait bénéfique, notamment via la création d’un comité des usagers consultatif.
En somme, les six premières années d’existence du Label Bas-Carbone marquent le début d’une ère prometteuse dans la lutte contre le changement climatique en France, mais cela nécessitera des efforts continus pour garantir son efficacité dans la transformation des pratiques en faveur de l’environnement.

Témoignages sur Le Label Bas-Carbone : un retour sur six ans d’impact et d’évolutions
Le Label Bas-Carbone (LBC), mis en place en 2018, a suscité de nombreux retours d’expérience et témoignages au fil de ses six années d’existence. Ce dispositif, qui contribue à la lutte contre le changement climatique, soulève à la fois des espoirs et des défis parmi les acteurs du secteur.
De nombreux agriculteurs ont partagé leur satisfaction d’avoir pu intégrer le LBC dans leurs pratiques. Pour certains, ce label est devenu un véritable levier de transformation de leurs méthodes de culture. « Depuis que nous avons intégré des pratiques bas-carbone dans notre exploitation, non seulement nous avons réduit nos émissions, mais nous avons également amélioré la qualité de nos sols, » témoigne un agriculteur du Sud-Ouest. « Cela nous a permis de diversifier nos revenus tout en prenant soin de la planète ».
Du côté des acteurs forestiers, le retour sur la reconstitution des forêts dégradées est particulièrement positif. Un responsable d’une ONGE forestière affirme : « Les projets de reboisement soutenus par le LBC nous ont permis de restaurer des terrains ravagés par des incendies. Avec une attention particulière sur la diversité des essences plantées, nous avons constaté une résilience accrue face aux changements climatiques ». Ces initiatives ont également suscité l’engouement de nouvelles entreprises qui voient dans le LBC une opportunité économique en phase avec leurs valeurs de durabilité.
Cependant, tous les retours ne sont pas optimistes. Certains acteurs soulignent les limites de l’évaluation des projets. « Nous constatons souvent des retards dans la validation des projets et un manque de clarté sur les paramètres de mesure, » explique un consultant en environnement. Cela crée des frustrations chez ceux qui souhaitent adhérer plus pleinement aux exigences du label.
Enfin, en matière de financement, les entreprises impliquées dans le LBC rendent compte d’une demande volatile et d’un narratif parfois moins séduisant autour des projets agricoles comparés aux projets forestiers. « Attirer des investisseurs pour des projets agricoles est un défi, car les prix de la tonne de CO2 sont souvent perçus comme trop élevés, » affirme un expert en finance verte. Cette perception pourrait freiner l’émergence de nouveaux projets dans le secteur agricole.
Malgré ces défis, l’engagement pour le Label Bas-Carbone reste fort et l’avenir du dispositif semble prometteur, avec une révision prévue pour 2024-2025 visant à améliorer sa gouvernance et sa transparence. Les acteurs du territoire continuent à se mobiliser pour transformer ces défis en opportunités d’évolution et renforcer les pratiques durables.

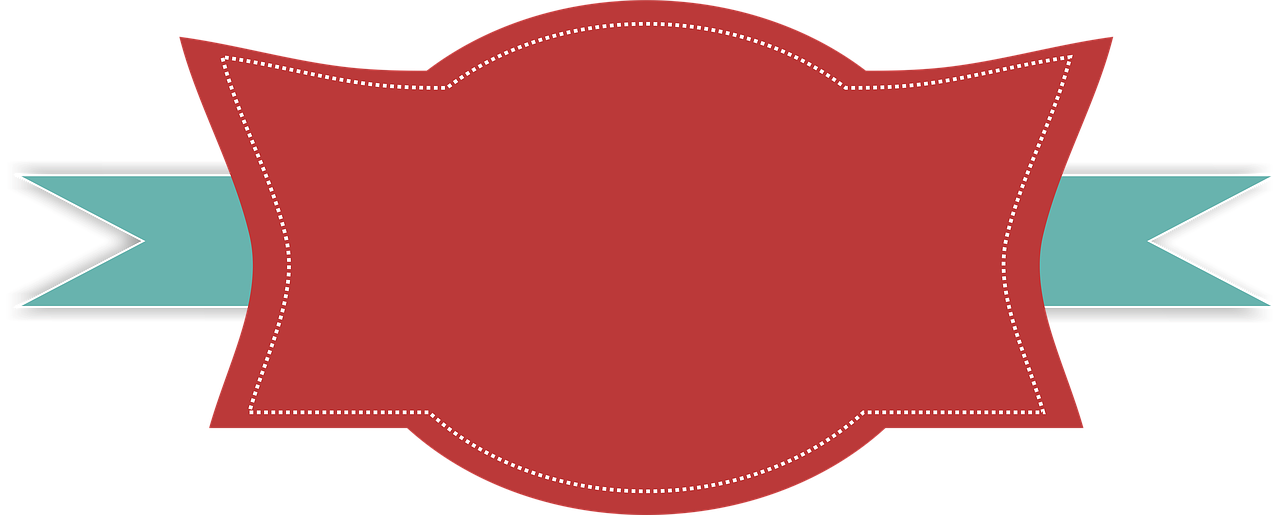
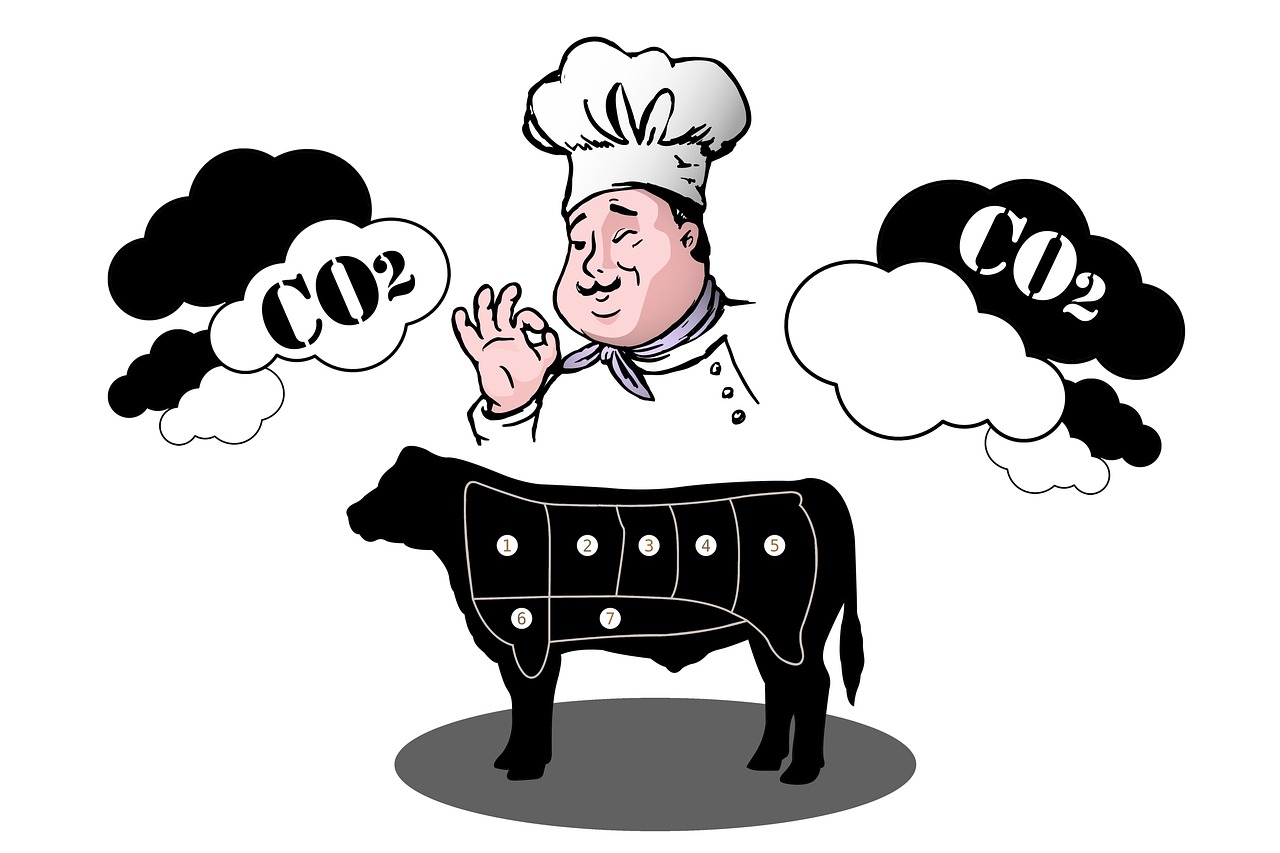








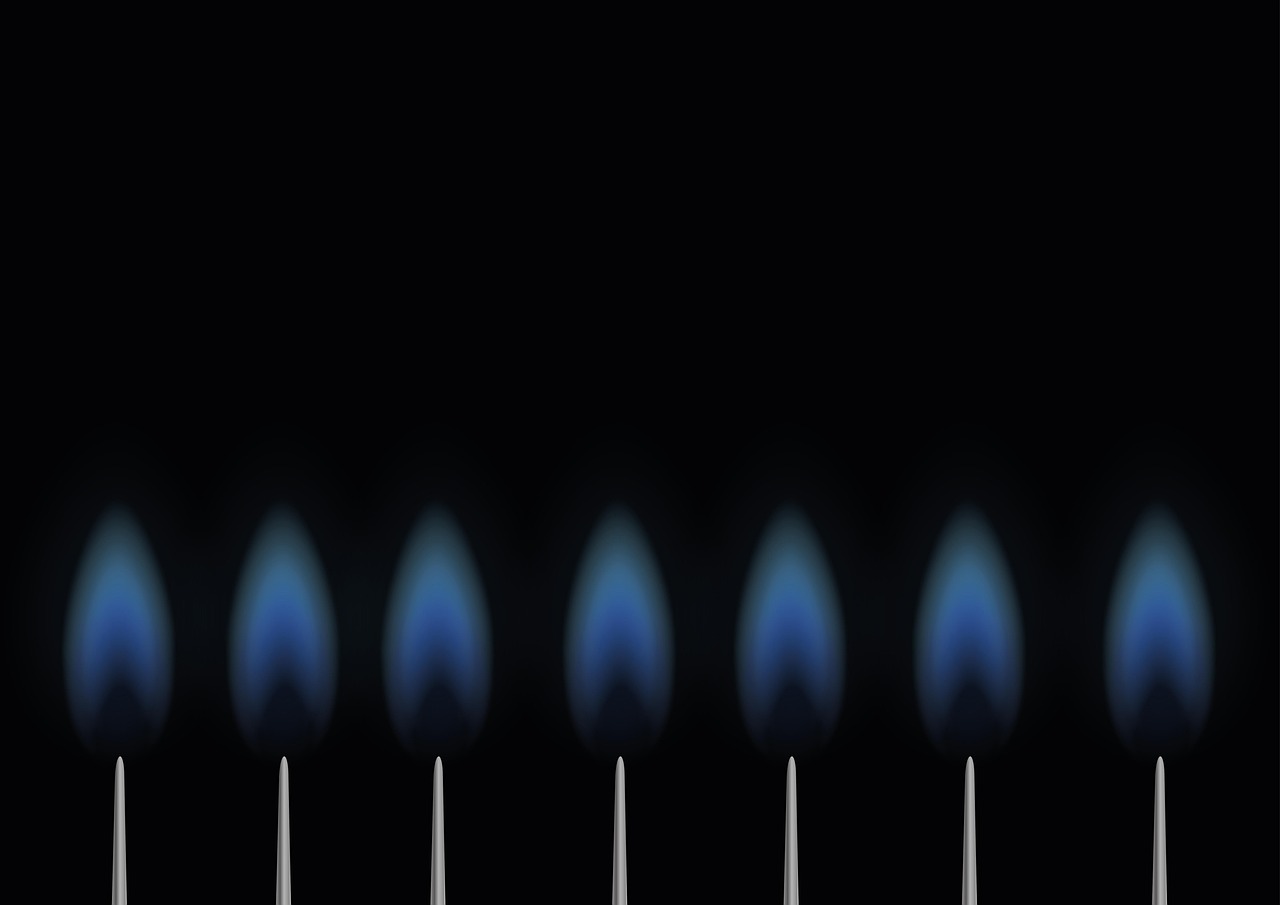




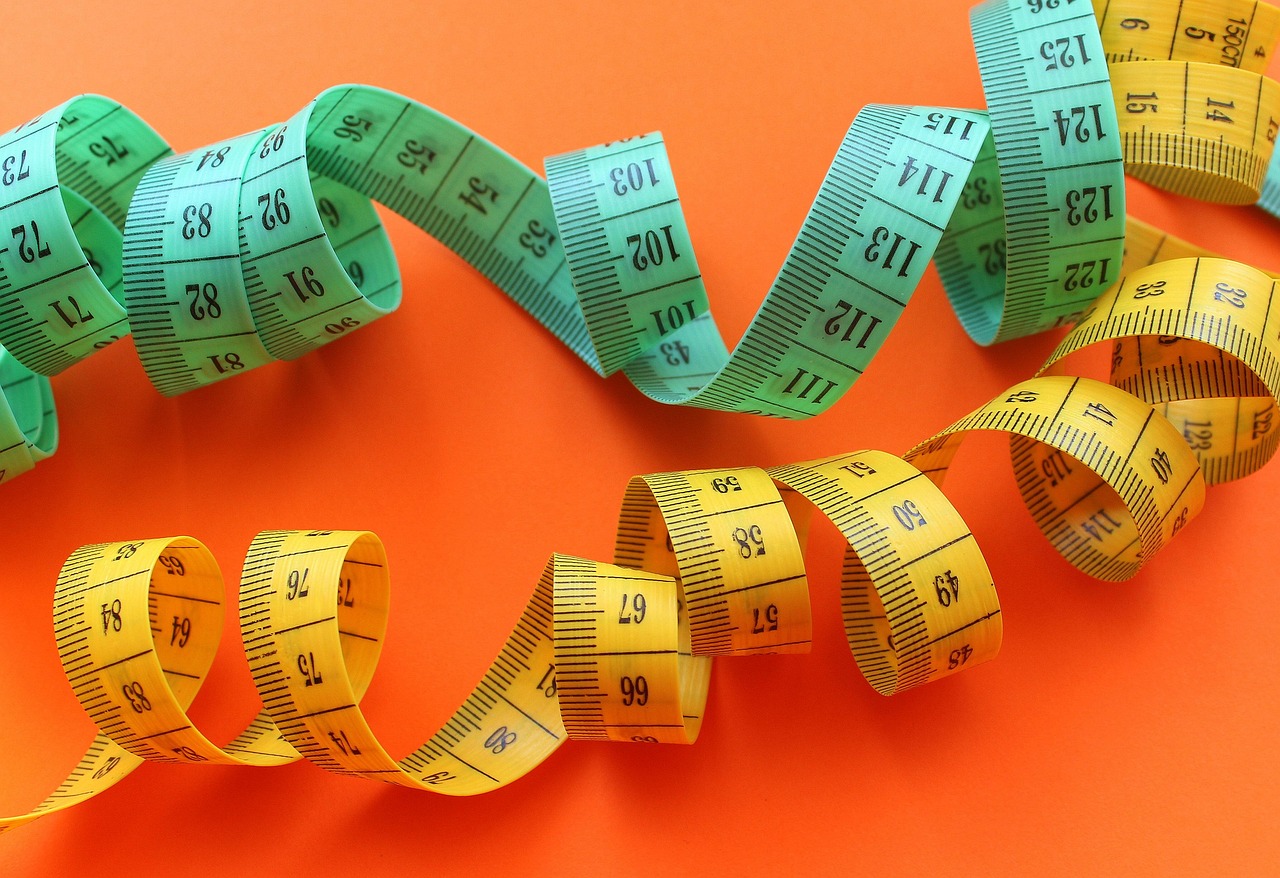



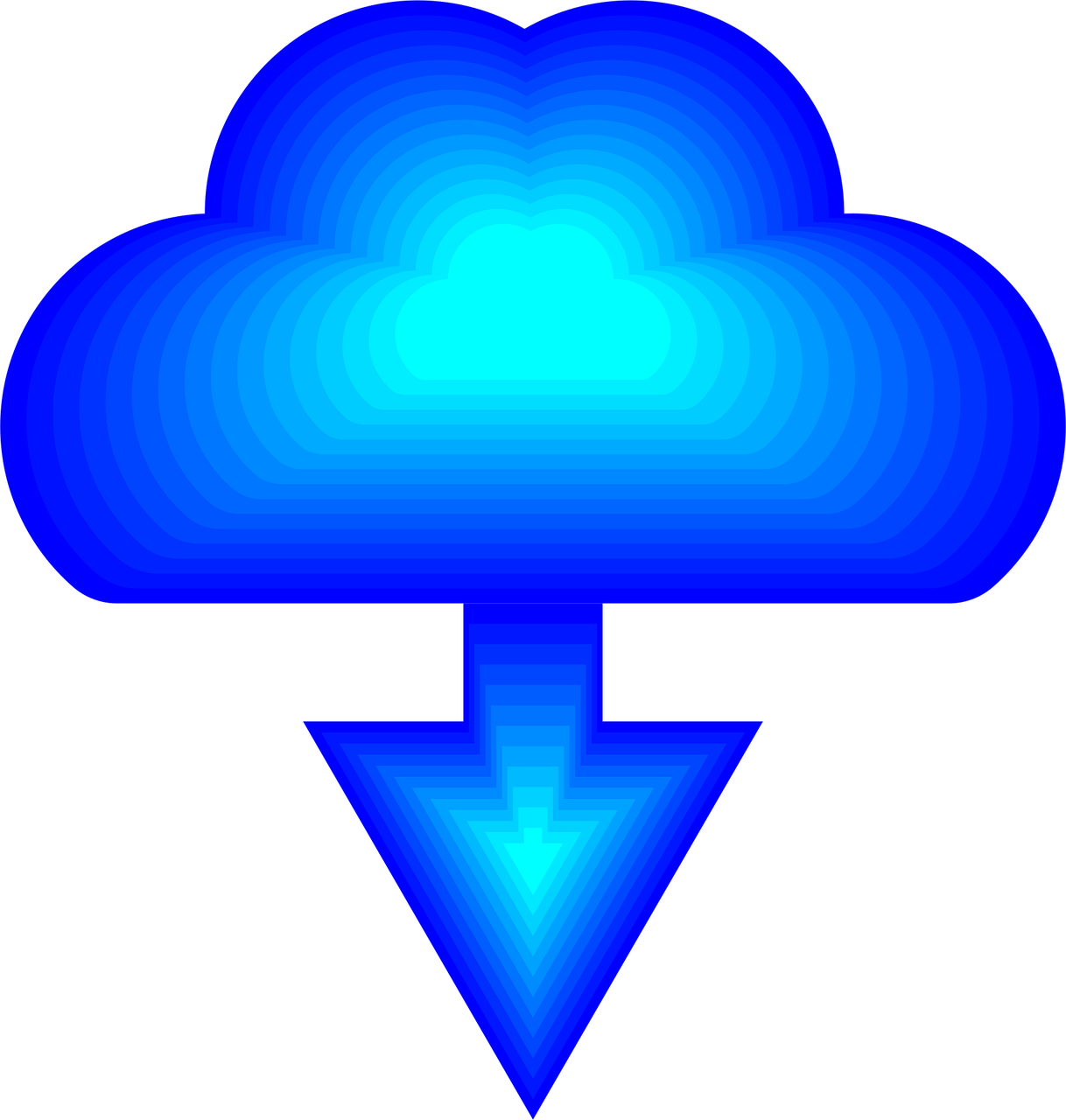


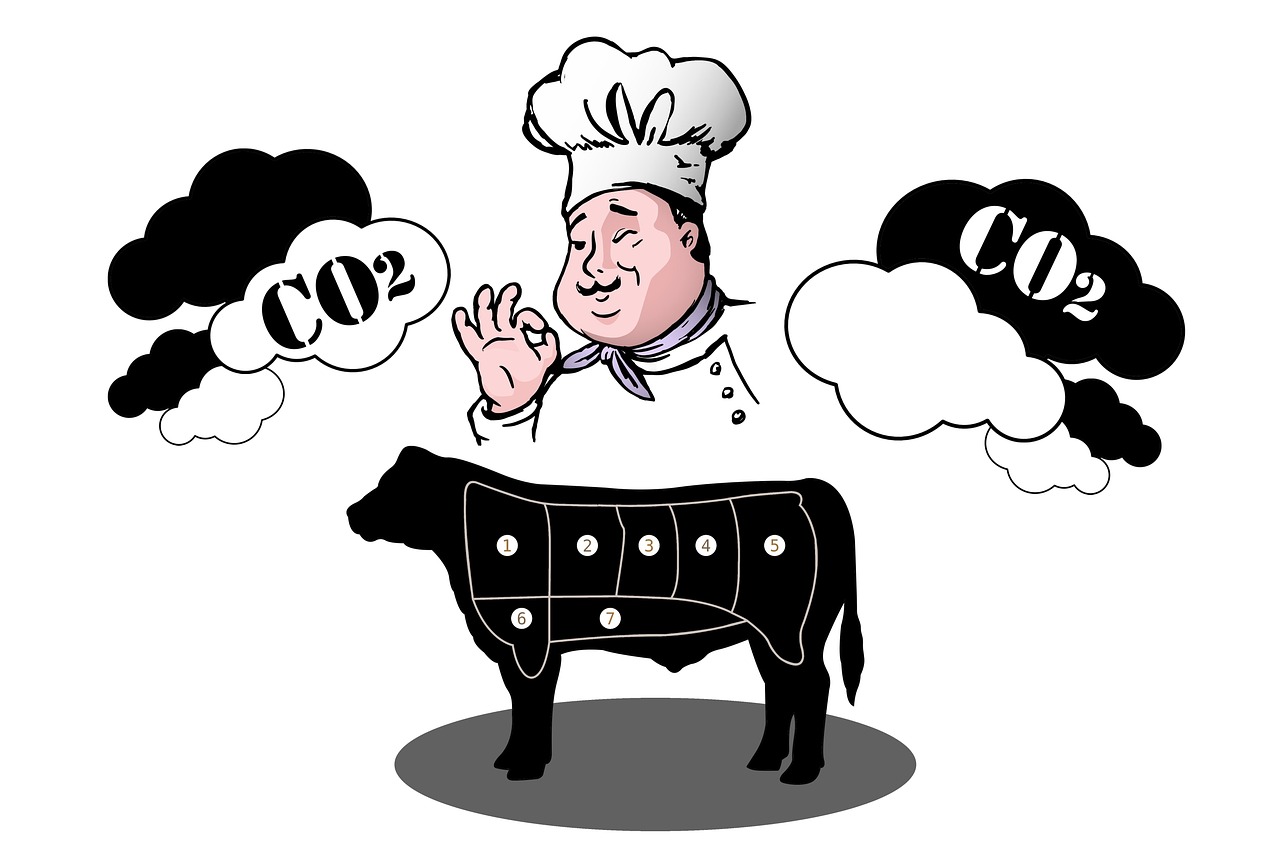




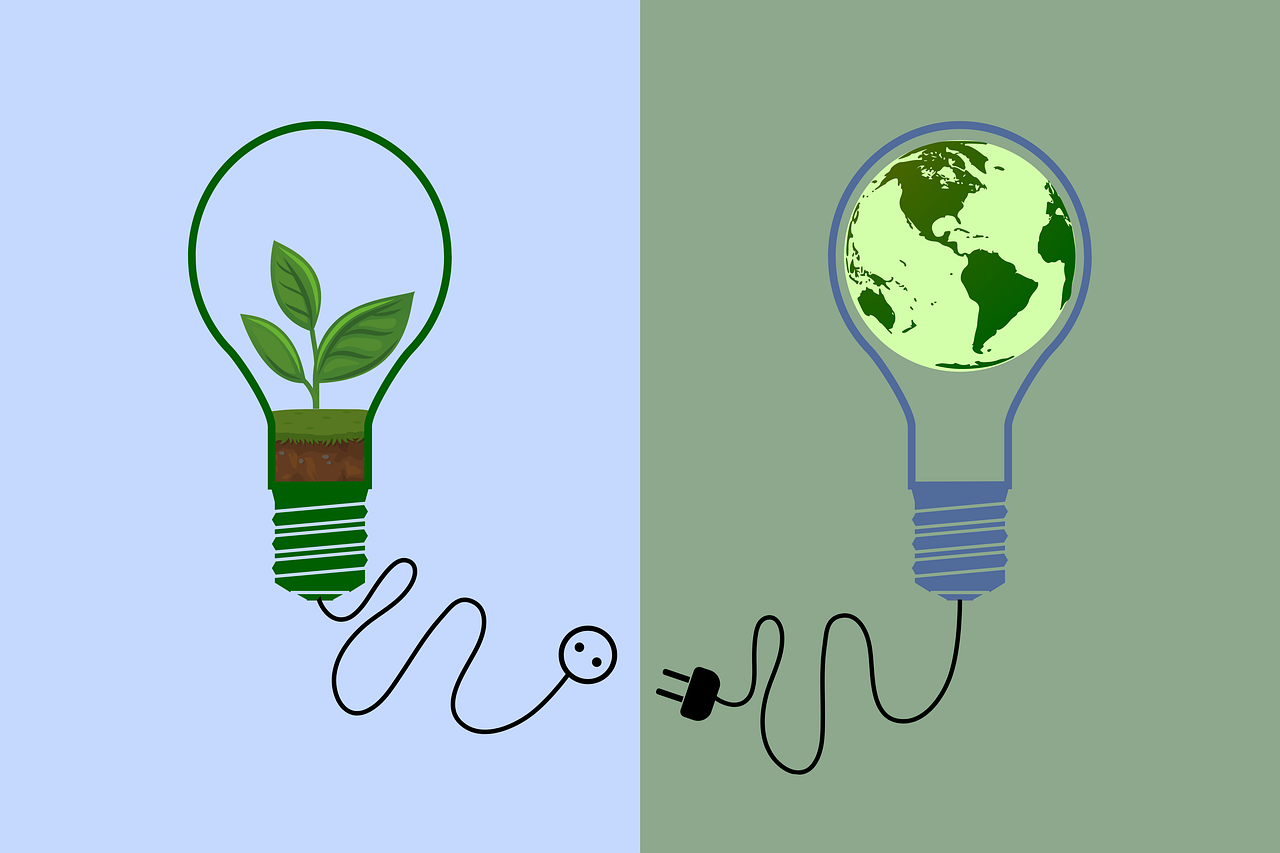
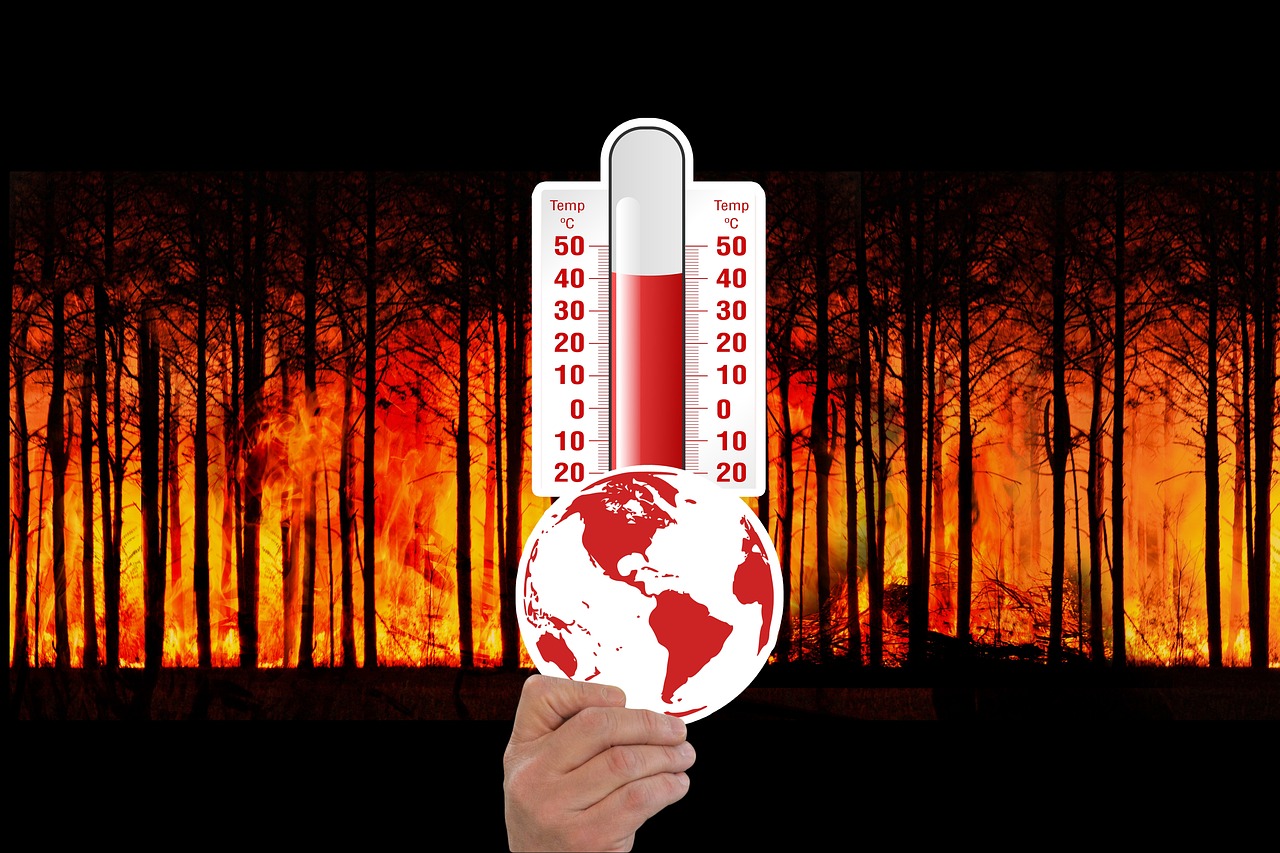

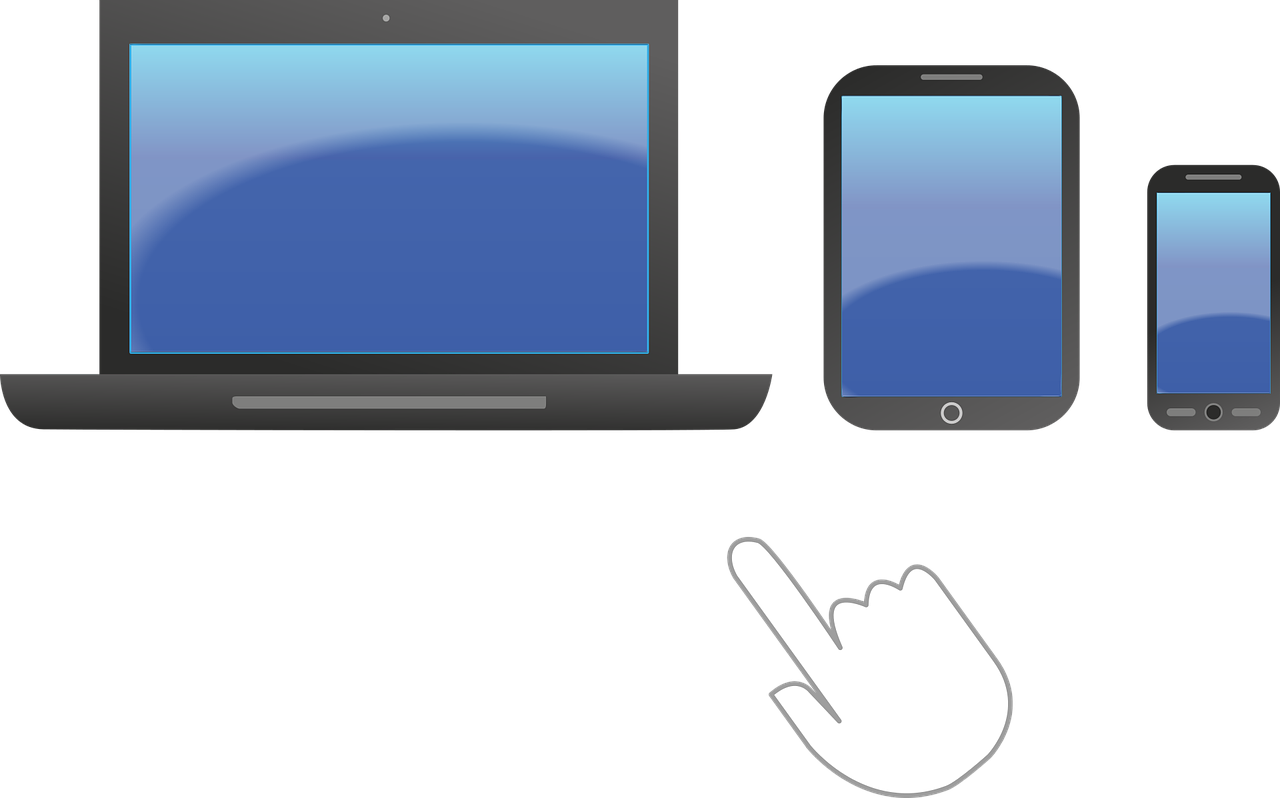
Leave a Reply