Face à la pression croissante sur les ressources en eau, les entreprises n’ont plus vraiment le luxe d’attendre. Entre les sécheresses à répétition, les coûts qui grimpent, et une réglementation de plus en plus stricte, la gestion durable de l’eau devient un vrai levier stratégique.
Et dans ce contexte, la récupération d’eau de pluie attire de plus en plus l’attention. Pas seulement pour verdir un rapport RSE. Mais pour réduire, de façon très concrète, les dépenses liées à la consommation d’eau.
Encore faut-il savoir si l’investissement en vaut la peine. C’est là que le calcul du retour sur investissement (ROI) devient essentiel.
À quoi peut servir l’eau de pluie en entreprise ?
On parle souvent de récupérer l’eau de pluie. Mais concrètement, pour quoi faire ? Dans une entreprise, beaucoup d’usages ne nécessitent pas d’eau potable. On pense aux sanitaires, au nettoyage des sols ou des véhicules, à l’arrosage des espaces verts, aux tours de refroidissement, voire à certains process industriels.
Tout dépend du secteur. Une plateforme logistique avec des entrepôts géants n’aura pas les mêmes besoins qu’un site industriel ou qu’un bâtiment tertiaire. Mais dans tous les cas, il y a des économies possibles.
Première étape : estimer les volumes récupérables à partir des surfaces disponibles, comme les toits ou les parkings. Ensuite, mettre ça en face des besoins réels. Et là, souvent, la surprise est de taille. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Ce qu’il faut pour mettre en place un système de récupération
Installer un système, ce n’est pas juste mettre une cuve sous une gouttière. Il faut penser à l’ensemble de la chaîne : surface de collecte étanche (souvent la toiture), préfiltration pour retirer les débris, cuve de stockage adaptée à la pluviométrie et aux usages, pompes, distribution… Bref, un vrai mini-réseau interne.
Certains clients s’appuient sur des partenaires spécialisés pour faire les bons choix techniques. C’est le cas de Eaux-Vives, qui intervient comme installateur de systèmes de récupération d’eau de pluie adaptés aux contraintes de chaque site. Leur expertise permet de dimensionner l’installation de manière réaliste, sans surcoût inutile. Pour en savoir plus sur leurs solutions, vous pouvez consulter leur page dédiée sur Eaux-Vives.
Les coûts à prendre en compte ? Il y en a plusieurs : installation, maintenance, gestion réglementaire. Mais ils doivent être regardés à la lumière des économies générées.
Comment calculer le ROI d’un tel projet ?
Impossible d’improviser un ROI. Il faut commencer par collecter quelques données de base : la pluviométrie locale, la surface exploitable pour capter l’eau, la consommation actuelle d’eau, et bien sûr son coût au mètre cube.
À partir de là, on peut simuler les économies annuelles : combien de m³ d’eau de pluie peuvent remplacer l’eau du réseau ? Quelle réduction sur la facture ?
On met ensuite ces économies en balance avec les coûts d’investissement (CAPEX) et les coûts de fonctionnement (OPEX). Cela donne un temps de retour sur investissement, souvent situé entre 5 et 7 ans. Dans certains cas, c’est encore plus rapide.
Si on pousse un peu plus loin, on peut aussi calculer le taux de rentabilité interne (TRI), qui donne une vision plus fine de la rentabilité du projet dans le temps.
Ce qui peut faire varier la rentabilité
Plusieurs facteurs peuvent influencer ce ROI. D’abord, les aides publiques. Certaines collectivités soutiennent activement ce type de projet avec des subventions ou des exonérations fiscales. Ensuite, le prix de l’eau. S’il augmente dans les prochaines années (et tout indique qu’il le fera), les économies seront d’autant plus intéressantes.
La durée de vie des équipements joue aussi. Un système bien conçu et bien entretenu peut durer 15 à 20 ans, voire plus.
Et puis il y a tous les bénéfices indirects. L’image RSE, l’anticipation des réglementations futures, ou encore la résilience en période de crise ou de sécheresse. On ne peut pas forcément les chiffrer tout de suite, mais ils pèsent lourd sur le long terme.
Un exemple concret pour se faire une idée
Prenons une entreprise avec un entrepôt de 5 000 m² dans une région recevant 800 mm de pluie par an. Elle pourrait capter entre 3 000 et 3 500 m³ d’eau de pluie chaque année. Si l’eau est facturée autour de 3 € le m³, l’économie atteint facilement 9 000 à 10 000 € par an.
Pour un investissement initial de 50 000 €, le retour se fait en 5 à 6 ans. Ensuite, ce sont des économies nettes, année après année.
Plusieurs entreprises ont déjà fait le choix d’investir. Pas seulement pour l’image, mais parce que les chiffres sont là.
Conclusion
Installer un système de récupération d’eau de pluie, ce n’est pas juste un geste pour la planète. C’est aussi, dans bien des cas, une décision rentable, logique, adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui.
Le calcul du ROI permet de prendre une décision éclairée. Et si l’investissement est bien pensé, bien intégré, il devient un atout stratégique.
Ce n’est pas juste une question de technique ou de tuyaux. C’est une façon de prendre les devants, de gagner en autonomie, et de mieux gérer une ressource qui va devenir de plus en plus précieuse.







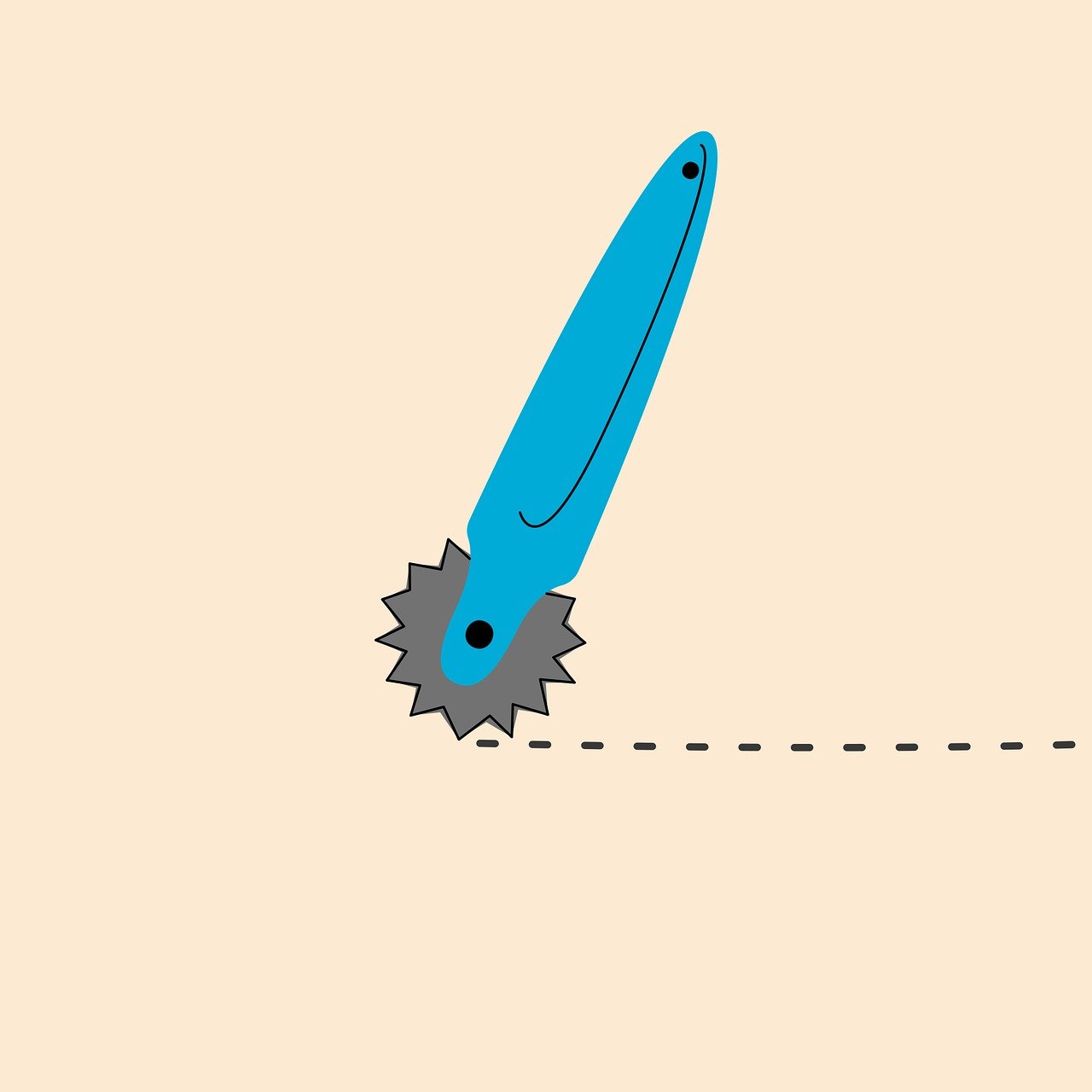

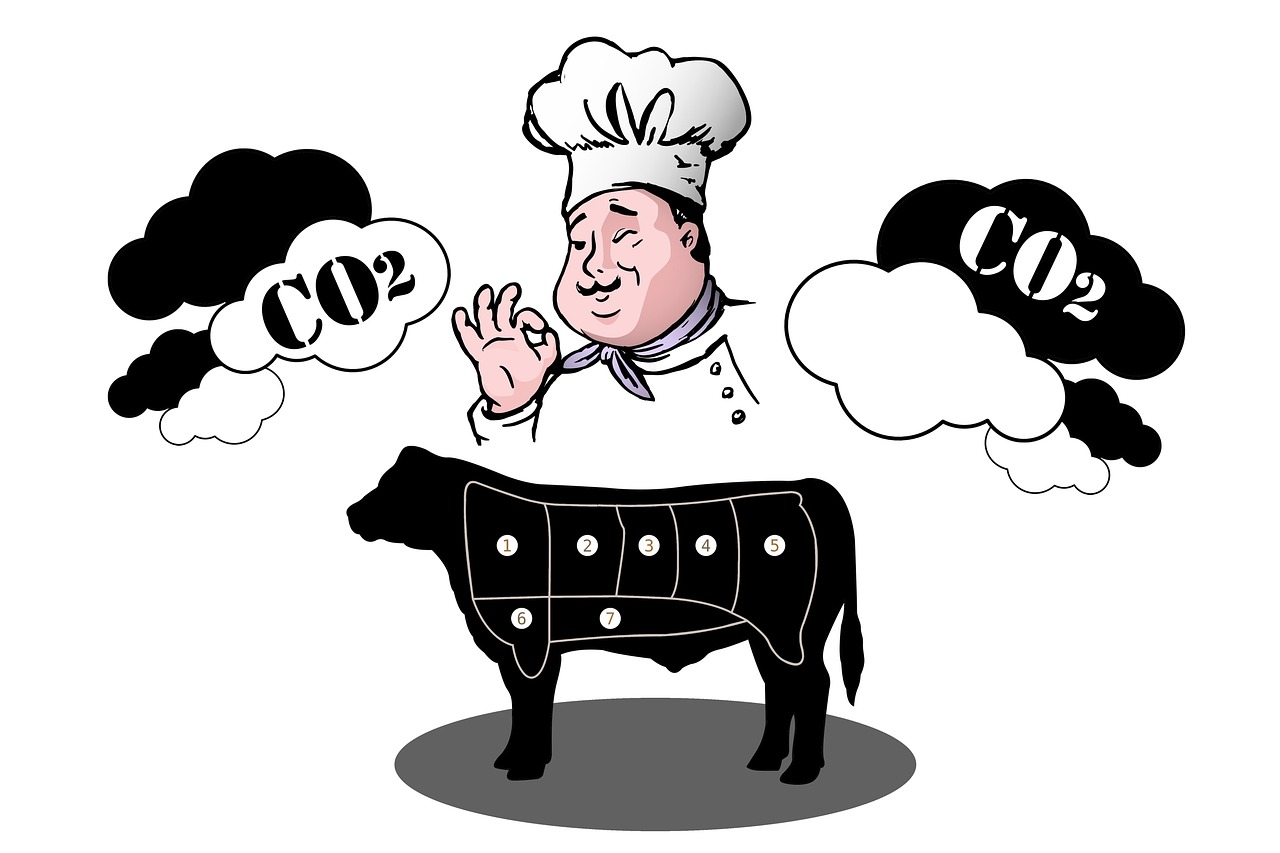














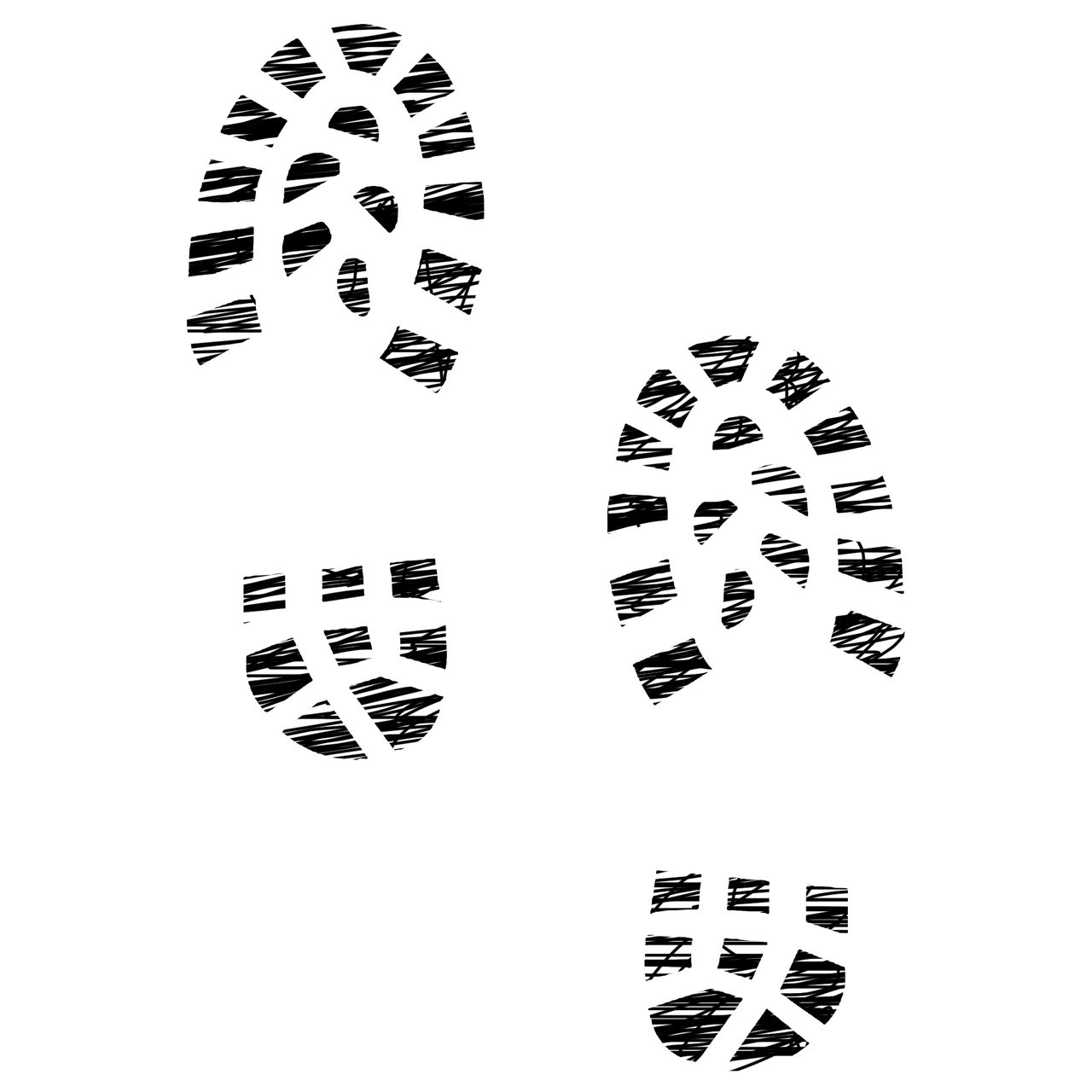










Leave a Reply