|
EN BREF
|
Le CNRS s’engage activement dans une transition écologique vers un modèle à faibles émissions de carbone. Initié fin 2022, ce plan ambitieux met en œuvre plusieurs leviers pour réduire son impact environnemental, notamment en sensibilisant et en formant ses agents aux problématiques écologiques. Parmi les actions notables, on trouve la mise en place de pratiques écoresponsables pour les achats, la réduction de la consommation énergétique de ses bâtiments, et la promotion des mobilités douces, comme l’utilisation du vélo. En un peu plus d’un an, le CNRS a déjà observé des résultats concrets grâce à ces initiatives.
Dans un monde de plus en plus paralysé par les effets du changement climatique, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) se présente comme un acteur clé dans la recherche et l’innovation visant à réduire les émissions de carbone. À la fin de l’année 2022, le CNRS a lancé une initiative ambitieuse pour atteindre une transition écologique à faibles émissions de carbone. Cet article explore les différentes actions mises en place par le CNRS, ainsi que les défis et les succès rencontrés dans ce parcours complexe mais essentiel.
Un plan de transition audacieux
Le plan de transition bas carbone du CNRS, qui a été initié à la fin de l’année 2022, représente une vision ambitieuse pour réduire l’impact environnemental de l’établissement. Ce plan repose sur plusieurs leviers permettant d’ancrer une culture de durabilité et de responsabilité au sein de l’organisation. Il inclut la sensibilisation et la formation des agents aux enjeux environnementaux, la mise en place de pratiques écoresponsables dans les achats, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.
Sensibilisation et formation : premiers pas vers le changement
Un des piliers fondamentaux de ce plan est la sensibilisation des agents du CNRS. Selon Blandine De Geyer, référente nationale développement durable du CNRS, l’intégration des agents dans ce processus est cruciale pour garantir un changement durable. L’animation du réseau de référents a déjà montré des signes positifs, avec des dynamiques engagées dans diverses délégations régionales. Par exemple, un cycle de formation sur la Fresque du climat, conçu pour éduquer et engager les employés, a vu la participation d’agents du CNRS ainsi que de partenaires externes.
Les défis de cette sensibilisation sont nombreux, comme le souligne Patrice Guyomar, référent développement durable de la délégation Occitanie Est. Les agents doivent être rassurés sur leur rôle de fresqueurs, un terme référant aux animateurs de fresques qui visent à illustrer les enjeux climatiques. « Être fresqueur, c’est avant tout être acteur du changement », explique Fanny Verhille, responsable formation, en soulignant que chaque agent peut participer selon ses disponibilités.
Approche d’achats responsables
Une autre composante essentielle de la transition écologique du CNRS réside dans l’implémentation de pratiques d’achats écoresponsables. Selon le bilan carbone de 2019, les achats représentaient 74 % de l’impact carbone de l’établissement. Il était donc essentiel de modifier en profondeur la manière dont le CNRS procède à ses acquisitions.
Les nouveaux standards d’achats
La direction déléguée aux achats et à l’innovation (DDAI) a initié un changement fondamental en mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. L’objectif est de « acheter moins pour acheter mieux », et une instruction sur les achats écoresponsables a été publiée dès le mois de mai 2023. Cette instruction imposait d’intégrer des critères environnementaux dans tous les marchés formalisés par les acheteurs régionaux.
En parallèle, la DDAI a constitué un groupe de travail avec des acheteurs régionaux pour établir des critères clairs et précis relatifs aux engagements des fournisseurs en matière d’emballages, de transport et de recyclabilité. Ce groupe vise à construire une matrice nationale pour encadrer le schéma de promotion des achats publics responsables, promouvant ainsi une approche écoresponsable durable.
Un secteur à l’épreuve : la restauration collective
Dans le cadre de ses efforts pour réduire son empreinte carbone, le CNRS a ciblé le secteur de la restauration collective, qui représente une part non négligeable de ses émissions de gaz à effet de serre. La région Occitanie Ouest, par exemple, a élaboré un plan ambitieux pour adapter les pratiques de restauration en y intégrant des critères environnementaux rigoristes dès le renouvellement de son marché.
De nouvelles pratiques alimentaires
Alcohol, plastiques, envolée des prix ; tous ces éléments poussent le CNRS à se recentrer sur la qualité des produits servis dans ses restaurants, comme le souligne Virginie Mahdi, déléguée régionale adjointe de la délégation Occitanie Ouest. À compter de 2025, les critères de choix des fournisseurs incluront jusqu’à 20 % d’évaluations portant sur des éléments sociaux et environnementaux.
Une diminution de la diversité des offres alimentaires a également été prévue pour réduire le gaspillage, avec un passage à moins de choix mais davantage de qualité. Les packs en plastique seront remplacés par des containers en dur et l’accent sera mis sur les produits locaux issus de l’agriculture biologique, favorisant ainsi une économie circulaire.
Optimisation énergétique des bâtiments
Outre les pratiques d’achats écoresponsables, le CNRS met également l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Bien que cela représente moins que les achats dans le bilan carbone global de l’établissement, les consommations énergétiques contribuent néanmoins à une part significative des émissions.
Des mesures d’atténuation efficaces
Des travaux significatifs ont été réalisés pour réduire la consommation d’énergie dans plusieurs locaux. Par exemple, le Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes a réussi une baisse de 37 % de sa consommation électrique en 2023, grâce à divers dispositifs d’économie d’énergie, tels que des panneaux photovoltaïques et un meilleur contrôle des systèmes de chauffage. De tels efforts permettent non seulement d’atteindre les objectifs ministériels, mais aussi de faire du CNRS un modèle en matière de transition énergétique.
Mobilités douces et durables
La question des déplacements domicile-travail représente un défi majeur pour le CNRS, où la voiture individuelle est une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre. En réponse, le CNRS a développé une politique de promotion des mobilités douces, visant en particulier les modes de transport alternatifs comme le vélo.
Le défi « Mai à vélo »
Dans le cadre de cette initiative, le CNRS a prévu de participer au challenge « Mai à vélo », où les employés seront encouragés à utiliser leurs vélos pour se rendre au travail. Les résultats précédents montrent que la participation massive pourrait avoir un impact significatif. En 2023, les agents du CNRS ont parcouru plus de 45 000 km à vélo, soit l’équivalent d’un tour de la Terre. Au-delà de cet aspect ludique, la promotion du vélo s’inscrit dans une stratégie plus large pour réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité de vie au travail.
Évaluation et perspectives d’avenir
Un an après le lancement du plan de transition, le CNRS a déjà pu évaluer certaines des réussites, mais aussi les freins qui subsistent. Des comptes rendus réguliers et des bilans vertueux sont nécessaires pour faire avancer la stratégie et garantir des efforts continus dans le but de conclure la transition bas carbone.
Chiffres et résultats concrets
En plus des mesures d’atténuation mises en place, le CNRS prépare un second bilan carbone, pour mettre en exergue l’évolution de ses émissions depuis le premier bilan réalisé en 2019. Cette démarche est essentielle pour ajuster et réorienter les actions actuelles. Les résultats de ce bilan permettront d’évaluer si les initiatives mises en place vont dans le sens d’une véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre et si le CNRS peut atteindre les objectifs fixés.
Enfin, un schéma directeur intégrant la responsabilité sociétale et le développement durable est en projet pour garantir que l’ensemble des initiatives entreprises soit aligné avec les valeurs fondamentales du CNRS.
Le CNRS avance vers la transition écologique à faibles émissions de carbone avec détermination. Chaque initiative, que ce soit dans le domaine de l’éducation, des achats, de la mobilité ou de l’efficacité énergétique, contribue à un cadre plus large d’actions en faveur de la durabilité, et démontre la manière dont la recherche peut être un moteur de changement positif au sein de l’organisation.

Le développement durable présente un paradoxe : ses effets ne sont pas toujours immédiatement visibles. Selon Blandine De Geyer, référente nationale développement durable, les plans de transition, comme celui du CNRS, nécessitent un temps d’sensitivity et d’accompagnement pour intégrer tous les collectifs de travail et instaurer un véritable changement. Cependant, dès un an après le lancement du plan, les dynamiques animées à travers les dix-sept délégations régionales témoignent d’engagements concrets.
Au cœur de ce chantier, la sensibilisation joue un rôle clé. Patrice Guyomar, référent développement durable de la délégation Occitanie Est, insiste sur l’importance de former les agents aux enjeux environnementaux. À travers des formations inédites sur la Fresque du climat, un groupe d’animateurs et d’animatrices a vu le jour, constituant ainsi un véritable vivier d’acteurs du changement au sein du CNRS.
Les défis ne manquent pas, comme le souligne Patrice Guyomar : jongler entre l’urgence d’agir et l’efficacité d’un plan d’actions bien structuré. L’engagement et la motivation des agents à devenir fresqueurs ont aussi nécessité des efforts de rassurance, puisque cette nouvelle mission s’accompagne d’une responsabilité importante : « Être fresqueur, c’est être acteur du changement », affirme Fanny Verhille.
En parallèle, le CNRS s’engage à réduire son impact carbone à travers des pratiques d’achats écoresponsables. En effet, les achats représentaient la majeure partie de l’impact du CNRS dans son bilan carbone de 2019. Le directeur de la direction déléguée aux achats et à l’innovation, Sébastien Turci, rappelle que l’organisme adopte une politique d’achat qui privilégie la qualité plutôt que la quantité, intégrant des critères environnementaux dès le mois de juin 2023.
La transition vers des pratiques durables se manifeste également dans la restauration collective, où des initiatives innovantes sont mises en œuvre. Virginie Mahdi, déléguée régionale adjointe, souligne l’importance d’expérimenter des pratiques responsables dans ce secteur, en introduisant des critères environnementaux significatifs dans les prochains contrats de restauration prévus en 2025.
Dans le cadre de sa transition, le CNRS améliore également l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Les travaux d’isolation ont permis une réduction de près de 8 % de la consommation d’énergie en un an, tout en mettant en place des systèmes durables qui profitent à l’environnement et à l’économie. Des efforts significatifs ont été observés dans des infrastructures, comme la gestion de la chaleur par le supercalculateur Jean-Zay, contribuant ainsi à un modèle de transition bas carbone.
Enfin, la promotion de la mobilité douce fait partie intégrante de cette transition. Le CNRS prévoit des aménagements pour encourager l’utilisation du vélo. L’organisation participe au challenge « Mai à vélo », qui encourage les agents à adopter ce moyen de transport, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail.



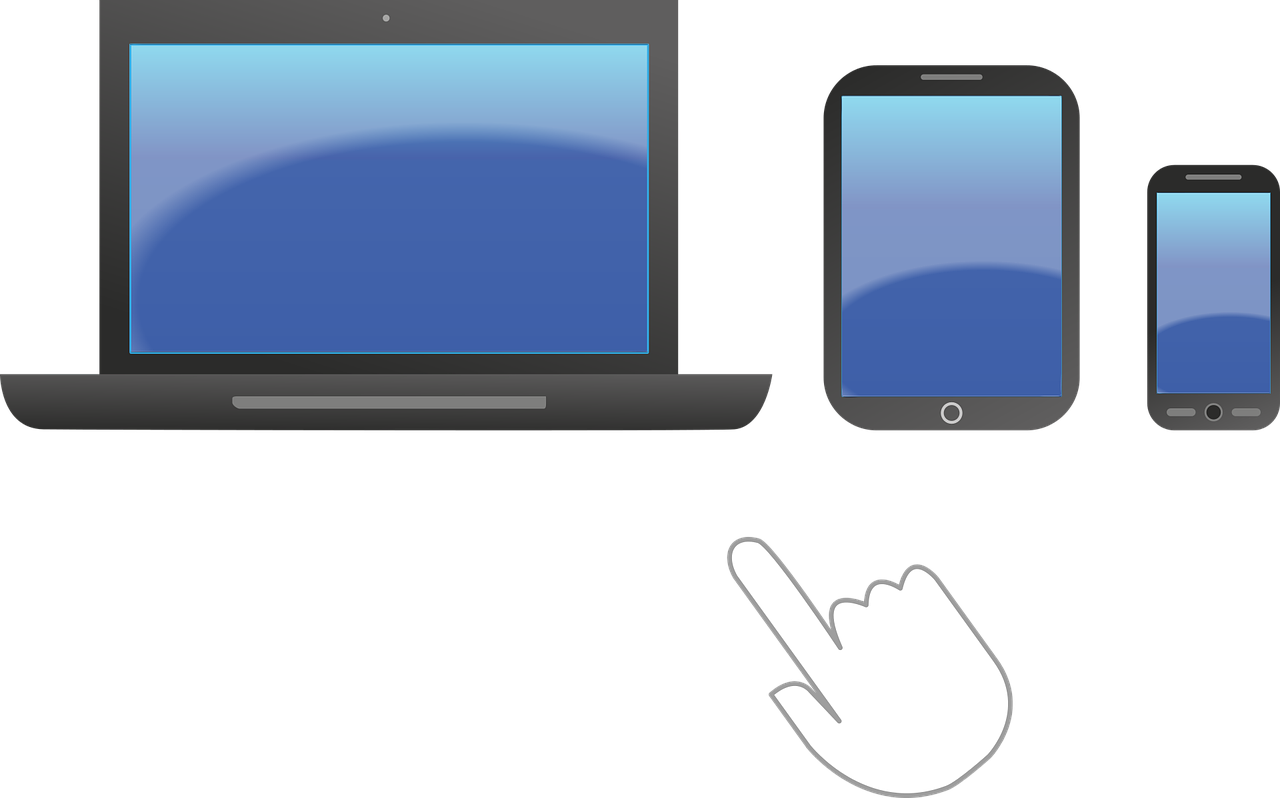




















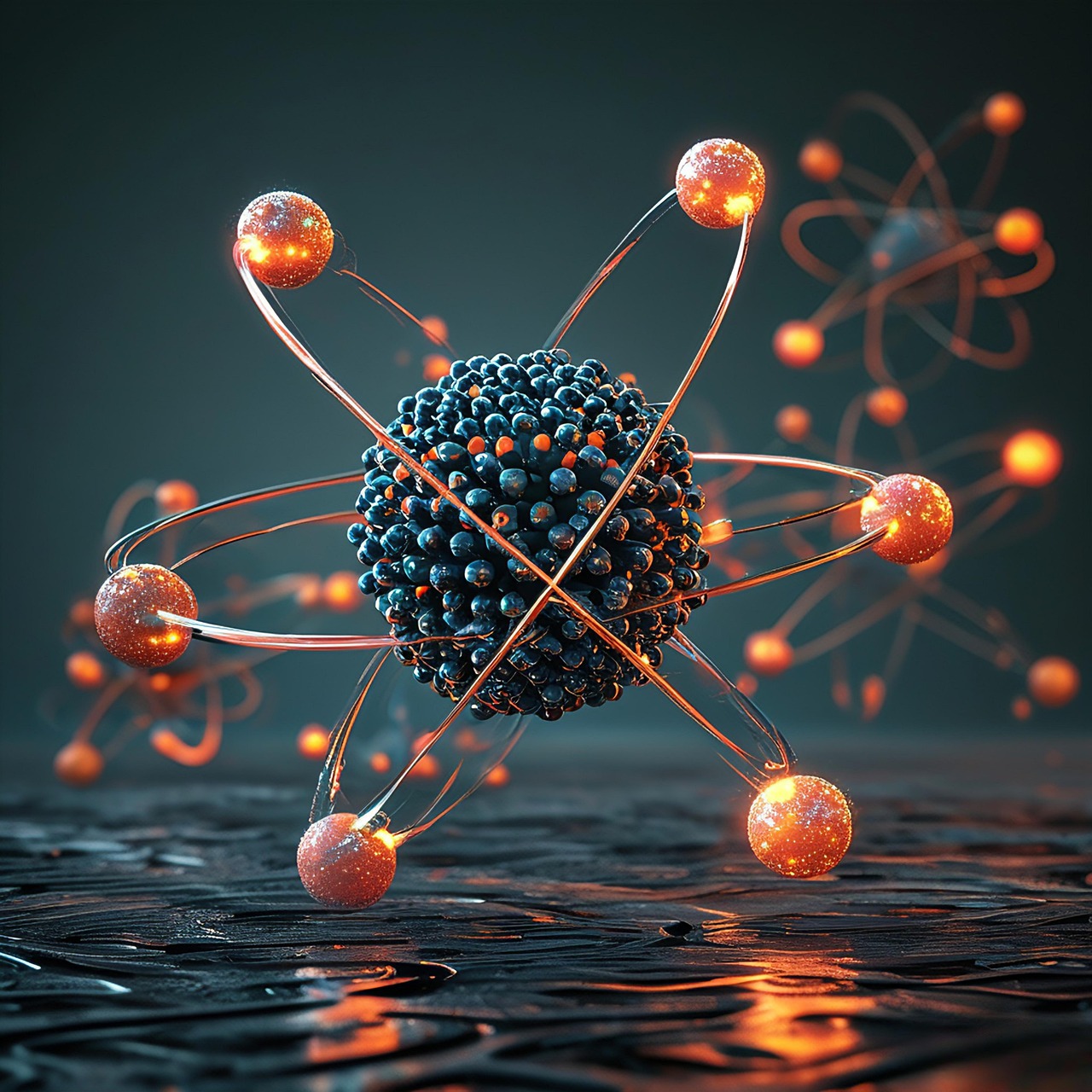
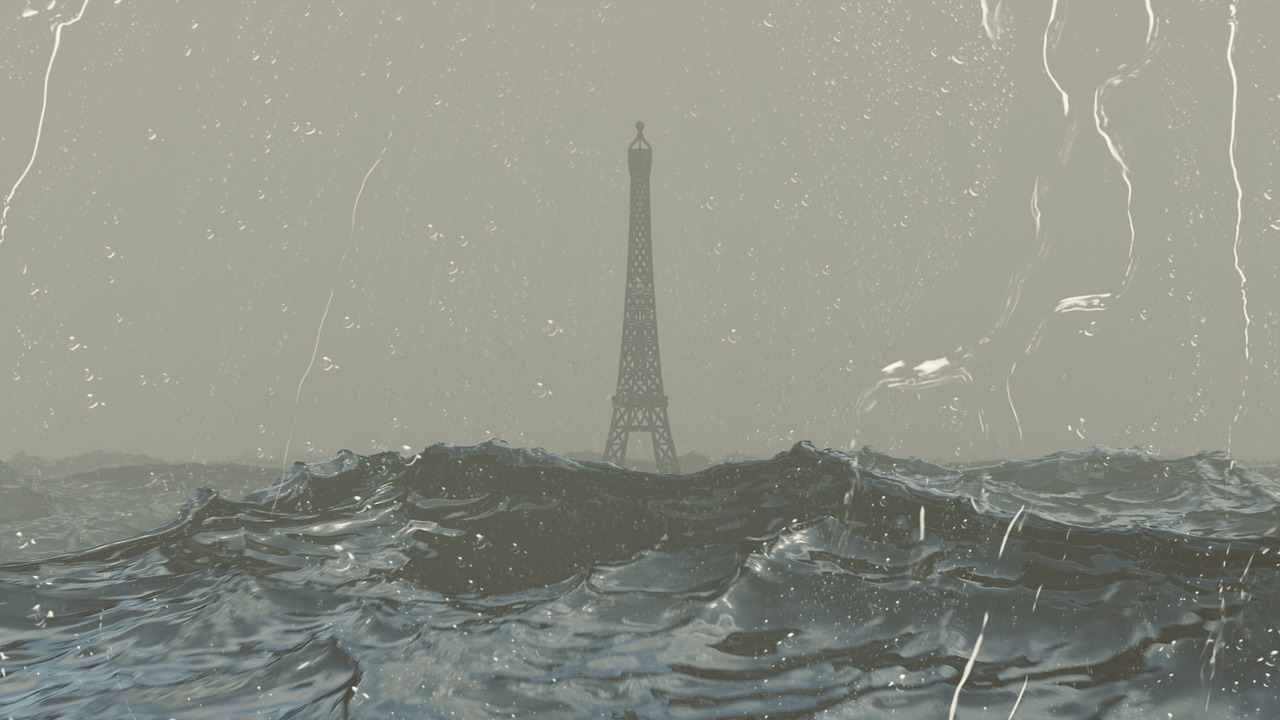









Leave a Reply